Année
2025
Droit des affaires en 12 thèmes
Eva Mouial Bassilana, Irina Parachkévova-Racine, Marina Teller
À travers une sélection de thématiques, les autrices, de cet ouvrage, ont voulu rendre compte des mouvements qui traversent le droit des affaires pour en saisir les forces souterraines, qui sont des moteurs d'innovation et de changement.
Conçu comme un outil pédagogique innovant, " Séquences " permet de multiples possibilités : les thèmes peuvent être étudiés en totalité ou pour partie, dans un ordre plutôt qu'un autre. Ces différentes combinaisons permettent de toucher un public varié aussi bien dans l'année concernée par la matière que dans des séminaires de niveau master ou des préparations aux concours.
À travers une sélection de thématiques, cet ouvrage met en lumière les fondamentaux du droit commercial et du droit des sociétés.
Cet ouvrage est complété d'une analyse plus spécifique de certains acteurs ou personnages-phares du droit des affaires.
D'autres thématiques transversales y sont présentées, permettant de rendre compte de toute la complexité de la vie des affaires et de l’organisation des entreprises.
Des mises en situation complètent l'ouvrage, permettant de contextualiser les sujets, afin de donner la dimension pragmatique ou encore réelle qu’un traitement purement théorique ne saurait à lui seul traduire.
Se procurer l'ouvrage
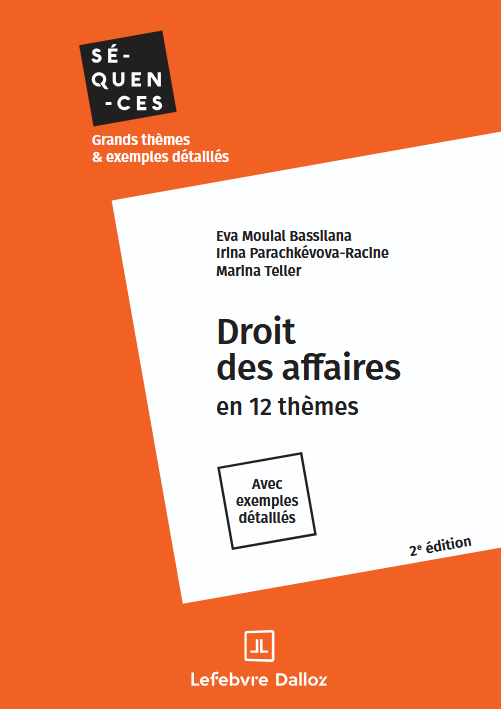
Editions: Groupe Lefebvre Dalloz
556 pages -
EAN : 9782247230624
Un autre monde du travail est possible
Sophia Galière et Anthony Hussenot
Le travail occupe une place centrale dans nos sociétés occidentales. Cette activité à laquelle nous nous préparons depuis notre plus jeune âge, représenterait plus de 36 ans de notre vie. Cette place du travail dans la vie de chacun s’est ainsi façonnée sur plusieurs siècles.
Comment les organisations, privées comme publiques, petites ou grandes, peuvent-elles repenser le monde du travail ? Comment faire évoluer les notions de temps de travail, de hiérarchie, de santé ?
Dans un style d’écriture simple et accessible, dans des chapitres courts et incisifs, 26 chercheurs partagent leurs analyses des mutations en cours.
Avec les contributions de Chahrazad Abdallah, Franck Aggeri, Anne-Sophie Barbe, Matthieu Battistelli, Yoann Bazin, Isabelle Billot Laroche, Jean-Pierre Boissin, Claudine Bonneau, Emmanuel Bonnet, Céline Bourbousson, Savéria Cecchi, Tarik Chakor, Rani J. Dang, Jean-Philippe Denis, Claire Estagnasié, Hugo Gaillard, Sophia Galière, Lionel Garreau, Anthony Hussenot, Bérénice Kübler, Aurélie Leclercq-Vandelannoitte, Aura Parmentier-Cajaiba, Gwenaëlle Prigent, Benoît Régent, Ève Saint-Germes et Bertrand Valiorgue.
Se procurer l'ouvrage

Editions: EMS
192 pages
ISBN : 978-2-38630-237-4
L'innovation au cœur des territoires
Territoires et transitions : construire l’économie de demain
Rani Dang
Pourquoi les réseaux humains et leurs interactions sont-ils source de créativité et d’innovation ?
Que nous enseignent les territoires innovants à travers le monde ? Quelles sont les clés d’analyse du succès de ces territoires ? Et surtout, comment analyser et développer les dynamiques d’innovation sur son propre territoire, à travers des plans d’action pragmatiques et efficients ?
Les transitions - écologiques, sociales ou encore économiques - que notre époque impose sont déjà en cours dans certains de nos territoires. Mais elles doivent avoir lieu partout, sans limite, ni frontière. C’est pourquoi ce livre propose une grille de lecture et d’action pour mettre en œuvre les mécanismes d’émergence et de développement en fonction des spécificités de chaque territoire.
Son ambition est d’éclairer et d’accompagner, dans leurs actions opérationnelles, les décideurs locaux et l’ensemble des acteurs d’un territoire, à travers le prisme de modèles d’analyse issus de la recherche sur les territoires innovants.
Se procurer l'ouvrage
RECUEIL D'ETUDES DE LA SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE
Gustavo Cerqueira, Nicolas Nord
Au cours des dix dernières années, la Société de législation comparée a produit une série d’études collectives sur les questions théoriques, méthodologiques et pratiques d’accès, de connaissance et de mise en œuvre du droit étranger.
Ces questions sont d’actualité. Le droit étranger occupe une place croissante dans la pratique, pour le juge bien entendu, mais aussi pour d’autres praticiens : notaire, officier de l’état civil, avocat notamment. Aussi bien en France qu’ailleurs, lorsque le juge, le notaire ou l’officier de l’état civil se voit dans l’obligation d’appliquer une loi étrangère, la connaissance et l’application d’un droit inconnu soulèvent des défis de tous ordres. Ces derniers sont d’autant plus redoutables que le traitement du droit étranger garde une dimension profondément nationale, malgré l’unification croissante des règles de conflit de lois en Europe et outre-Atlantique.
Les études de la Société de législation comparée ont pour ambition d’aller au-delà des analyses convenues. Explorant le droit positif de plusieurs pays et régions, elles abordent les zones d’ombre, les insuffisances, les contradictions…nombreuses dans ce qui constitue l’essence même du droit international privé.
Ces études sont désormais réunies dans ce recueil, afin d’offrir aux universitaires et praticiens l’ensemble des réflexions menées par des juristes de différents horizons sur les questions les plus saillantes relatives à ce chapitre souvent délaissé du conflit de lois, ainsi que leurs propositions visant à assurer l’établissement le plus fidèle de la teneur du droit étranger.
Se procurer l'ouvrage
Année
2024
GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES AU XXIe SIÈCLE
Clotide Coron, Lise Gastaldi, Eve Saint-Germes, Séverine Ventolini
Ce manuel promeut une approche renouvelée et contemporaine de la GRH face aux défis du XXIe siècle. Il propose des outils analytiques pour mener un diagnostic exigeant de la GRH et repenser les politiques et les pratiques existantes, afin d’intégrer pleinement les enjeux actuels. Parmi ceux-ci, citons les transformations du travail et des organisations, la santé au travail, le renouvellement des générations et le besoin accru de sens, la diversité et l’égalité, l’innovation, la digitalisation et, bien sûr, la crise climatique et énergétique. Ce manuel comprend des éléments théoriques, des références clés et des illustrations, exemples et cas pratiques. Il offre un guide complet pour les personnes qui étudient, enseignent ou pratiquent la GRH.
Il s’adresse ainsi aux étudiantes et étudiants dans des licences ou des masters de gestion ou de GRH, et de toutes autres filières comprenant des enseignements de GRH, ainsi qu’à celles et ceux qui préparent des concours incluant cette discipline. Il pourra également intéresser les enseignantes et enseignants de cours de GRH ou proches (comportement organisationnel, introduction à la gestion, management général, RSE), dans les différentes formations de l’enseignement supérieur comme dans le secondaire et en classes préparatoires. Enfin, il s’adresse aussi aux praticiennes et praticiens de la GRH et aux managers qui s’interrogent sur l’adéquation de leurs pratiques avec les réalités et les enjeux du XXIe siècle.
Ce manuel est structuré en quatre parties intitulées : renouveler la GRH ; repenser les pratiques de GRH ; innover en GRH et grâce à la GRH ; engager la fonction RH dans les défis sociaux et environnementaux. Il s’achève par une conclusion qui interroge comment (se) former à la GRH, proposant des pistes concrètes pour soutenir la capacité de la GRH à relever les défis de notre siècle.
Se procurer l'ouvrage

Editions: EMS
pp336
ISBN : 978-2-37687-988-6
Droit et animal
Pour un droit des relations avec les humains
Isabelle Doussan
Cet essai part du constat que le traitement juridique de l’animal n’est pas assez pensé en termes relationnels, alors même que les rapports entre humains et animaux, domestiques ou sauvages, sont divers et bien réels : utilité, risque,protection, attachement. Il pose les bases d’un droit de la production animale en mobilisant les notions de sensibilité, de vulnérabilité et de nécessité. Il montre un droit en prise avec les transformations de nos rapports aux animaux et évoque les voies d’évolution possibles.
Le traitement juridique de l’animal est rarement pensé en termes relationnels, alors même que les rapports entre humains et animaux sont divers et bien réels. Relevant d’un courant de réflexion sur les relations entre humains et non-humains,cet ouvrage s’intéresse à l’animal domestique et sauvage dans le champ du droit et explore, sans que la liste soit exhaustive, une diversité de relations : utilité, risque,protection, attachement.
Cette diversité ne doit pas faire oublier que le droit est aussi un instrument du pouvoir qu’exercent les humains sur les animaux, et dont il fixe les limites. Leur sensibilité, souvent considérée comme une propriété intrinsèque reconnue parle droit, peut questionner le rapport de pouvoir que nous entretenons avec les animaux.
Tout en refusant la tentation de la personnification juridique, l’auteure pose les bases d’un droit de la production animale en mobilisant les notions de vulnérabilité et de nécessité.
Ce travail montre un droit en prise avec les transformations de nos rapports aux animaux et évoque les voies d’évolution possibles, dont chacun, acteur de la société civile, professionnel de l’élevage ou chercheur, peut se saisir.
Se procurer l'ouvrage

Editions: Quae
PP88
Collection : Essais
ISBN-10 : 2759238296
ISBN-13 : 978-2759238293
- Année 2023
- Année 2022
- Année 2021
- Année 2020
- Année 2019
- Année 2018




